En plaçant sa caméra de l’autre côté des murs du camp d’extermination d’Auschwitz, du point de vue de la famille du commandant de ce dernier, Jonathan Glazer dilate des formes qui mènent vers l’inconcevable. Jusqu’à tordre la fiction et la représentativité même de la shoah.

Il y a quelque chose d’inconcevable qui se dégage du visionnage de The Zone of Interest. C’est d’abord une question de point de vue (une vie quotidienne quasi-paradisiaque juxtaposée au camp d’extermination d’Auschwitz et menée par la famille de Rudolph Höss, commandant de ce dernier), et surtout la façon de le filmer. La mise en scène produit un effet trouble entre cette histoire vraie et sa représentation. Nous pourrions partir du principe que cette zone cultivée, faite de jardins et de chic bourgeoisie, serait le contrechamp de l’extermination : voici aussi ce qui se passait pendant que ça se passait – une forme de banalité du mal comme l’entendait Anna Arendt. C’est une mise en lumière sur un fait peu connu de l’histoire d’Auschwitz, déjà raconté par Martin Amis dans son livre, et dont il faut mesurer la pareille importance du fait de sa proximité avec l’horreur des crimes contre l’humanité. Une révélation dans, pourtant, une incompatibilité des plus extrêmes : les auteurs de ces horreurs ne seront jamais filmés dans leurs méfaits. C’est toute la violence du en même temps, l’incapacité de voir ensemble les deux faces d’une même pièce autrement que par la tranche qui les relie.
Une tranche dont l’épaisseur, la radicalité de sa forme et de sa conceptualisation va nous conduire d’un côté comme de l’autre du camp sur le principe, en premier lieu, d’un seul et même plan. Nous aurons par exemple la famille de Rudolph Höss en train de fêter son anniversaire autour d’une table à manger, tandis que nous distinguons l’une des tours de contrôle du camp d’Auschwitz par la fenêtre positionnée juste derrière le commandant. Cela peut-être une fenêtre, ou juste un amas de plantes qui sépare les juifs forcés à travailler d’une balade à cheval du commandant avec son fils. Des échos de cris tandis que deux enfants longent une serre qui enferme les plantes. Un coquelicot dont la couleur rouge débordera jusqu’à remplir l’image (comme le faisait Ingmar Bergman dans Cris et chuchotements). Rudolf Höss lui-même qui imagine comment gazer une vaste pièce où dansent officiers et représentants du parti nazi, loin du camp. Art délicat de la suggestion et de l’association par l’unité du plan, libéré étonnamment de tout effet de montage (à nuancer plus tard), qui ne se limite pas à une dimension cérébrale liée à l’inconscient collectif que suscite toute la représentativité de la Shoah, mais qui justement dilate toutes les frontières et l’organisation de la mise en scène.
C’est une représentation loin d’être épurée, mais motivée par d’inséparables contradictions où les plus belles beautés renversent la dimension horrifique : une forêt qui jouxte une rivière, des fleurs dont les couleurs pétillent aux yeux, une vie de campagne ornée d’une piscine préfabriquée ou d’un perron qui mène à la porte d’entrée et, sur la droite, une petite terrasse. Si l’objectif de la mise en scène est bien d’apporter un contrechamp à la Shoah, ce qu’elle filme et donc ce qui se passe annule toute idée de rebasculement du regard vers ce qui, de l’autre côté du mur et des barbelés, est en train de se tramer. Le champ serait alors absent. La violence du film ne repose pas sur une possible mentalisation de la Shoah par effet d’assemblage entre une fumée en arrière-plan et un jardin en train de pousser, mais bien sur ce qu’induit l’indomptabilité de ce trésor floral, la prédation d’un tel mode de vie et l’immense protection dont repose chaque recoin extérieur ou intérieur de cette vie familiale. Exemple parfait : quand la femme du commandant, Edwig (interprétée par Sandra Hüller), tient son bébé et lui montre des fleurs, elle ne regarde pas ni ne fait de signes vers les murs et barbelés situés sur le coin supérieur gauche de l’image : car ce n’est pas ce qui se passe. Juste les fleurs, la position du bébé, et les mots à priori attendrissants de la mère pour son enfant, comme un murmure.
Le regard vers les fours et le nez qui sent l’odeur des cendres qui s’en échappent sont exercés par un seul personnage : la mère d’Edwig, venue lui rendre visite, portant toute son admiration pour ce train de vie, avant de s’en aller après la constatation de l’enfer se passant de l’autre côté. Le spectateur pourrait adopter la même posture que le personnage de la mère. Arrivant sur ce lieu de vie, sans poser le pied dans le camp, constatant en même temps la beauté puis l’horreur depuis sa fenêtre (le reflet des flammes surimprimées sur son visage), en pleine nuit. Pourtant, elle ne sert pas de point de repères : elle s’en va, mais jamais avec nous. Nous resterons – emprise, ici, du point de vue. Un départ par ailleurs situé hors champ, appris en hâte par sa fille. Ce que la mère traverse, nous ne le traversons pas. La scène de la visite du jardin entre Edwig et sa mère, assez longue et filmée en travelling, isole cette dernière plus qu’elle ne l’implante dans le récit : l’isole de sa fille mais aussi du spectateur. Edwig et sa mère s’assoient enfin sur des bancs fabriqués avec de grosses branches de cerisiers, privées de leur fleurs, dont l’aspect tortueux et la couleur de sang séché (sans oublier les murs du camp à l’arrière-plan) désynchronise le dialogue, le projet de visite, et donc une conscientisation. Le travelling annule le simple mouvement de la visite, épousant davantage ce jardin langoureux (des branches contrepassent devant la caméra). Un reflet évident, mais terrible, d’une vie voulue et assumée, rectiligne, pensée jusque dans le moindre détail.
Ce qui se passe, donc. Le travelling, précis et langoureux du fait de la beauté de ce jardin, relaie aussi l’idée d’une vie parfaite sans le moindre accroc qui peut rappeler la méthode d’assouvissement et de soin du commandant du camp, et évoque plus frontalement les envies d’éternité de sa femme (le jardin semble s’expansée). En effet, lorsqu’elle apprend que la désaffection de son mari la contraindra à abandonner tout ce qu’elle a accompli à Auschwitz, elle le supplie non seulement de garder cette maison, mais aussi pour l’éternité. Ce qui se joue dans cet à-côté du camp, au-delà de l’association (peu appuyée) entre paradis et enfer, l’instantanée et l’éternité, c’est le mouvement des vies de ces gens. The Zone of Interest ne propose en aucun cas un portrait inerte d’un contexte que l’on aurait tendance à résumer par l’unique question de sa représentativité : c’est aussi l’histoire d’une œuvre en cours, ou le moindre recoin de cette zone devient une découverte, un espace en mouvement. Il y a le jardin, bien sûr, ou encore le sous-sol que traverse Höss après avoir couché avec sa maitresse, dont l’issue se trouve à l’intérieur même de sa maison, ce qui donne un effet labyrinthe entre ce qui relève justement du caché (le sous-sol) et du visible (la maison). Chaque zone naturelle induit également un déplacement – le film s’ouvre par ailleurs sur un pique-nique au bord d’un fleuve, avant que l’on suive la famille Höss prendre la voiture pour rejoindre la maison. Nous suivrons Rudolf Höss hors de la géographie d’Auschwitz, vers sa nouvelle affectation qui, dans l’Histoire, le conduira à imaginer des nouveaux travaux au camp pour accélérer le processus, en cours, de la Solution Finale.
Le mouvement, comme le montrent le travelling du jardin et le plan fixe suivant qui délimite ce dernier, se constate aussi au montage et surtout dans la maison des Höss. Chaque pièce de celle-ci semble constituer d’un ou plusieurs angles de caméra qui vont revenir plusieurs fois au rythme des déplacements des personnages. Quand un personnage traverse par exemple la cuisine, l’angle de prise de vue sera le même pour un autre personnage et ainsi de suite. Si la trajectoire du personnage va vers une pièce à-côté, c’est l’angle de cette dernière qui sera adopté, encore. Chaque pièce, et donc toute la géographie de la maison, est identifiable pour des mouvements greffés à des angles de prises de vues. Sensation d’installation de caméras par ici, par-là, du quasi direct, propre à une surveillance, qui pour autant ne masque pas l’ambition de Jonathan Glazer de lubrifier son entreprise de mouvement, précise certes, mais complètement en écho avec ce qui se passe. Quand Edwig essaie devant son miroir un manteau qui se dévoile autant par sa fourrure que son volume, la scène doit contourner le personnage pour mieux cerner ce qui se passe dans l’appréciation de l’objet : un essayage pure et classique. Se serait se tromper que de dire qu’Edwig ne fait qu’essayer un manteau qui appartenait à une déportée. Cela annulerait tout mouvement, tout enjeu spatial et narratif.
La mise en scène, alors, par rapport à ce qui se passe, ni n’oublie toute représentation de la Shoah au profit d’un focus sur la vie de ces gens ni ne relègue tel ou tel niveau au premier ou second plan, mais filme une forme d’inconcevabilité, quelque chose d’indisposé, à partir duquel il faut produire un mouvement, un véritable point de vue : un espace à-côté d’un autre espace. De la même manière que Under the Skin avec le corps humain et Birth dans le thème de la réincarnation, Glazer se faufile sous la représentation pour produire son filmage : non pas pour rendre compte à l’Histoire mais pour produire, face au spectateur, un contrechamp d’une ampleur inédite, quelque part caché ou inavoué car en combat avec un champ d’action non pas absent, mais qui ne se montre pas véritablement.
C’est à la fin du film que se produit probablement le seul champ-contrechamp, en tout cas le plus notable et le plus sensible à tout ce que j’ai pu démontrer, entre les deux « zones ». Lorsque Rudolph Höss, descendant les escaliers du bâtiment qu’il s’apprêtent à quitter pour retourner à Auschwitz, est attiré du regard par une lumière blanche qui n’est en fait que le trou d’une porte menant aux fours crématoires entretenus, de nos jours, par le personnel du Mémorial et Musée d’Auschwitz-Birkenau. Jonathan Glazer éclate ici toute idée de représentation, et confronte réellement le tueur et ses crimes, le passé et le présent, la fiction et le réel, la violence d’hier et la violence d’aujourd’hui. Une scène glaçante et extrêmement émouvante sur la préservation comme sauvegarde de ce qui a été caché, à travers des salles dans lesquelles sont enfermés toutes ces chaussures, tous ces habits, toutes ses valises… Salles aussi transparentes que nos yeux recevant des images. Un geste qui répond à la démarche du film, production démente, sans mesure et mouvementée d’un à-côté et d’une difformité de la représentation : si nous avons tout vu à-côté du camp, comment voir ce qui a été enterré, bunkerisé, gazé, cramé ? En convoquant le souvenir de ce qui s’est passé. Seuls Lanzmann et Resnais avait réussi à produire un tel effet. Glazer, dans ce qu’il apporte de déplacement et d’éclatement, contribue et projette la violence dans un état encore plus proche que nous.

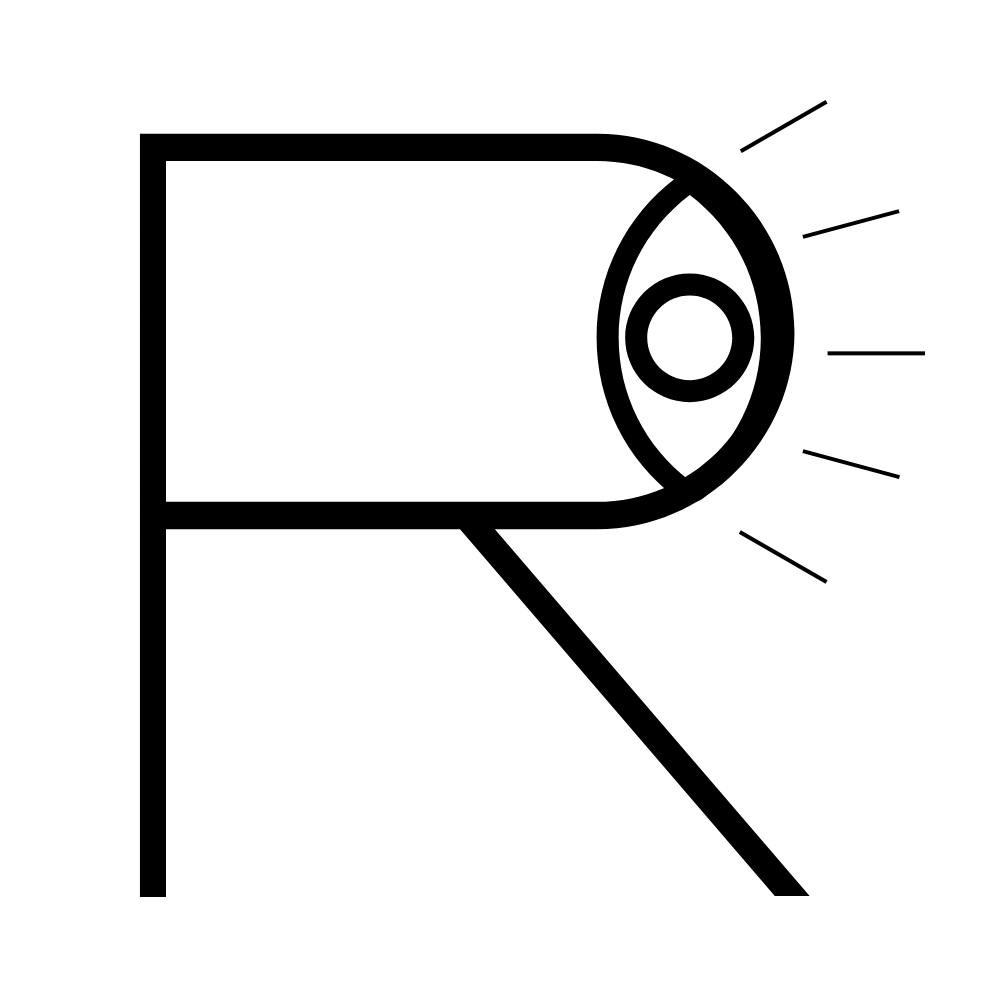

Laisser un commentaire