Avec Put your soul on your hand and walk, Sepideh Farsi ouvre la voie vers une représentation en direct du génocide en cours à Gaza. un geste à la fois en direct et à distance. Avec, au centre, la figure permanente et désarmante de Fatima Hassouna, dont l’innocence et la présence marquent l’esprit de manière indélébile.

« Reconnexion », c’est ce mot qui apparait quand la connexion internet quasi-inexistante de Fatima Hassouna, photographe palestinienne tuée le 16 avril 2025 par l’armée israélienne et jusqu’alors captive à Gaza sous le feu des bombardements et de l’occupation, coupe l’appel en visio avec Sepideh Farsi de manière momentanée ou sinon avant que ce dernier ne s’arrête brusquement. Ce mot pourrait bien résumer le geste de la cinéaste, dont le film adopte le point de vue (caméra au poing) lors des conversations filmées avec Fatima, cette jeune femme quelque part de l’autre côté du miroir et dont la coupure du reflet vient engendrer l’urgence de la revoir, juste un instant, par envie de comprendre, de lui parler, de ressentir – tenir le fil de la discussion, se reconnecter avec elle. Le film est en effet traversé par cette forme de nécessité de la répétition, dont la véritable nature se révèle au fur et à mesure du filmage : il s’agit autant de rendre compte de la situation tragique que parcourent actuellement les Palestiniens que de nouer un lien affectif avec celle dont les yeux (la photographie), la voix et le sourire en sont les principaux témoins. Ce serait, par poncif, la petite histoire dans la grande. A ceci près que la mise en scène vient toucher une représentativité tout à fait directe : du fait d’une forme d’actualité dont la cinéaste ne se prive jamais de rendre compte, et dont le versant intime vient provoquer une curiosité allant du plus flou des pixels à la plus nette des photographies de Fatima.
Les discussions entre les deux femmes vont bien au-delà d’une caisse de résonance : c’est la fabrique d’une résilience et d’une innocence par le pouvoir intime des images. Et cela vaudra toujours plus que les belles paroles des beaux dirigeants du beau monde libre. C’est d’abord l’image d’une conversation, encadrée par la petite lucarne d’un smartphone branché sous visio, surcadré par la présence d’un autre téléphone, cette fois-ci porté par la cinéaste, dont le visage et la main porteuse reflètent sur l’écran. Mais le double dispositif de Sepideh Farsi – le téléphone du visio, et le téléphone qui filme – vient se greffer aux images montrées par Fatima lors des échanges : son visage et son humeur, bien sûr, et j’y reviendrai, mais aussi parfois ce qu’il y a de l’autre côté. Par exemple une fumée au loin qu’elle pointe du doigt, quasi-indicible du fait de la mauvaise qualité de la réception, mais dont il est impossible de douter de la présence, ou sinon quelques membres de la famille qui saluent la réalisatrice, des portraits de personnes proches et décédées et envoyés sur un fil de discussion WhatsApp…
Le film est un véritable flux d’images dont les différentes variations de ce qui est montré ouvrent les vannes d’une représentation en direct, une sorte d’économie du dispositif (par l’absence de visions frontales ou choquantes) qui permet la pleine mesure d’une sensation renouvelée dans le documentaire de guerre : l’intimité. Et c’est en ce sens que les magnifiques photographies de Fatima Hassouna, observables par ailleurs sur son compte Instagram (encore actif), ne sont pas montrées dans ce film sous l’effet d’un sensationnalisme et contribuent à l’économie dramatique : car c’est le respect de son regard comme celle de ses intentions qui perdurent à l’écran, avec sa voix qui transparaît parfois par-dessus. Fatima est la clef de voûte d’une émotion à double entrée, comme décrit plus haut : directe et intime. Et c’est bien cela qui motive la cinéaste à enchainer les interactions, sans transition, en mentionnant leurs dates (et donc les intervalles, plus ou moins longs). D’autant que le geste de documentaire devient lui aussi de plus en plus intime : des chats à faire rentrer, quelques traversées rapides à travers son salon, quelques mentions des différentes localisations depuis lesquelles elle fait l’appel… Si l’enjeu du film est quadrillé par les quatre côtés d’un écran de téléphone, c’est aussi ce naturalisme dans la prise de vue qui accompagne le rapport direct et intime aux différents motifs que sous-tend le drame en cours.
Et au cœur de ces deux côtés de l’intimité, le sourire de Fatima Hassouna. Il est très difficile de regarder ce film sans penser une seule seconde au destin tragique qu’elle a subit. Ce si beau sourire témoin, comme déjà dit, d’une résilience et d’une résistance, et dont la lecture permet aussi de traverser une autre frontière que celle de la géographie ou de l’écran de téléphone : celle qui sépare l’espoir du désespoir. L’une des discussions filmées par la cinéaste révèle au grand jour une sensation qui s’installe : quand la première lui pose la question si elle n’est pas en train de s’évanouir, elle et sa personnalité solaire, innocente. Quand la cinéaste pose la question, et que Fatima semble de plus en plus démunie, tout devient désarmant, y compris la moindre résurgence de ce sourire qui imprime la caméra, inonde le drame d’une forme de croyance ô combien mystique, d’une insaisissable aisance dans le tragique. Voilà tout l’inconfort, tout le drame que cela crée de voir « disparaitre » (tel est le mot employé par la cinéaste) une personne dont la seule présence et le seul sourire pourraient sauver des vies entières. La reconnexion opère également à ce moment-là, quand il faut s’accrocher à ce qui demeure, et se demander où est passé le reste. Ainsi, le simple visage de Fatima, même si celui-ci est orné de pixels ou saccade toutes les trois secondes, devient plus qu’une image : c’est une référence, un point de repère d’un certain comportement et, en fin de compte, d’une partie de la monographie de Gaza à l’heure où les bombes pleuvent.
Face à cet étalage d’une telle intimité en direct, aussi tragique et désarmante soit-elle, il est si difficile de comprendre, de réaliser ce que les yeux voient et ce que les oreilles entendent. Face à la difficulté d’une telle réalisation, et donc de la fabrication de la représentation d’un tel drame, qui plus est contemporain, il est difficile de ne pas faire de lien avec La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer. Certes, celui-ci ne montre pas, mais sait ce qu’il se joue de l’autre côté : c’est dans ce rapport au savoir (les nazis dans le film, oui, mais aussi les spectateur·rices) et au drame à peine croyable qui se joue en direct – pendant le film – que les deux gestes de Glazer et Farsi peuvent se rapprocher. D’autant que les films ont la tendance de se conclure par le même motif de l’aller-retour. Glazer entreprend un tournant documentaire à l’approche du final de sa fiction en posant sa caméra dans les couloirs du Musée National d’Auschwitz-Birkenau avant de revenir sur son protagoniste, principal responsable des horreurs exposées dans ce dernier tandis que Farsi opère une rupture à son dispositif en montrant une longue vidéo tournée en plan-séquence par Fatima Hassouna explorant les décombres de Gaza (alors que jusqu’à présent ce n’étaient que des photographies fixes), avant de revenir, à son tour, vers le point de référence d’une discussion filmée, la dernière, avec la photographe, seule et unique témoin du massacre en cours. Si Glazer révélait bien l’urgence mortifère, génocidaire et immontrable d’une certaine zone, Farsi révèle elle aussi une zone où réside le drame, mais ici entrecoupée d’un sourire aussi fragile que brillant, d’une innocence aussi vive que touchante, d’une aura testamentaire que je peinerai à oublier, et que je chercherai coûte que coûte à défendre : Fatima Hassouna, la raison de ma reconnexion avec Gaza et, j’espère, de la vôtre – de la nôtre.

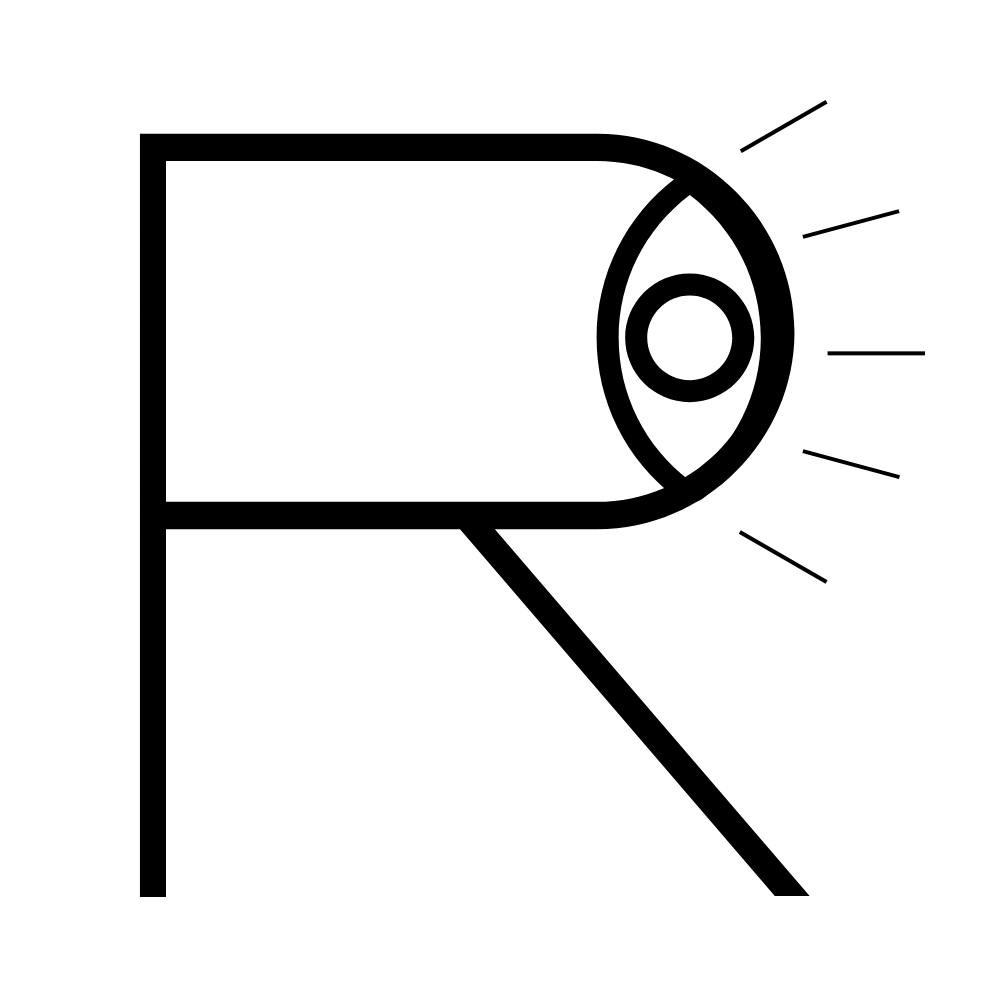

Laisser un commentaire