Avec Alpha, Julia Ducournau creuse dans les failles de son cinéma en y déposant cette fois l’histoire d’une famille traumatisée par un virus. Un film gangréné par des effets putassiers et une iconographie laide en plus d’être fière.

Si Julia Ducournau tient absolument à nous regarder si longtemps dans les yeux dans la dernière image de son nouveau film Alpha, qu’elle prenne autant le temps de jeter un œil sur le système de mise en scène qui la vue naître aux yeux de toustes et qui, avec ce film, le rend paradoxalement irregardable. Après une Palme d’Or on ne peut plus contestable compte tenu de sa teneur dégoulinante de vanité et pseudo-consciente sur la vie et la mort – et remise par un cinéaste tout aussi discutable si l’on en observe la filmographie récente –, la cinéaste est prise en flagrant délire d’augmentation de gravité de chacun de ses motifs, de chacune de ses scènes de son dernier film. C’est une certaine pratique du cinéma, mais pour de faux.
Le cinéma de Julia Ducournau est un circuit dont la lecture repose sur la faculté du film à jongler entre différentes iconographies sans y proposer une seule répercussion ni trouble. Il s’agit bien d’une méthode, sinon d’un style, qui ne révèle, entendons-nous bien, aucune forme d’altérité, ni de sensibilité ni de radicalité. Si chaque film d’une filmographie d’un.e cinéaste constitue le reflet d’un autre, celle de Ducournau s’enlace avec des copies : une série de « m’as-tu vu ? » piégée par une esthétique fédératrice et regardable – donc encore plus discutable – consistant à élever le cinéma de genre. Tout cela ressemble davantage à des tentatives désespérées, révélant une certaine fébrilité déjà présente dans tous ses films si la virgule orangeâtre de sa photographie, trempée dans l’hémoglobine type O (pour zéro), ne vient pas vous gripper à votre tour. Par exemple, même si le dernier acte de Alpha se revendique d’un cinéma davantage labyrinthique, dopée à la fameuse formule lynchienne à laquelle tout.e cinéaste qui y a déjà goûté ne s’en est jamais vraiment remi·e·s, et durant lequel les personnages semblent enfin circuler dans un monde cloisonné par une laideur dénuée de détails, tout n’est que l’illustration du symptôme du cinéma de Ducournau : raconter une certaine douleur traumatique au prix d’effets putassiers où la toile iconographique tissée par ses personnages (une petite fille ça grandit, un toxico ça se pique et une mère ça chiale) vient annuler toute émotion et vérité dans le montage (la jeune fille est vue à la fois en ado et en enfant) et le récit (musique grandiloquente, interprétation au rabais). Un ramassis de conneries assorties d’une forme d’incompétence : tout cela pourrait bien réintroduire tout un pan du cinéma de genre que la cinéaste s’est attelée à passer sous silence inconsciemment.
Si le cinéma, c’est « pour de faux », il est tout aussi sûr que ce genre de film n’a pour ressort et motivation que l’implication de ses effets dans tout ce qu’ils visent. En prenant le problème à l’inverse, et en faisant ainsi faire évoluer des personnages dans une tornade de tournures à en faire perdre la tête (une scène de repas assourdissante, des conjonctions temporelles faussement mystérieuses, un faux intérêt pour le harcèlement scolaire), Julia Ducournau a fini par céder à la tentation de l’excentrisme borderline. Pour de faux donc, c’est-à-dire qui ne résiste pas, qui fait défaut à tout ce qu’elle cherche à raconter. Ce qu’elle cherche, oui, car on ne sait pas bien ce qu’elle y trouve. Au-delà de toute considération esthétique, que pourrait bien raconter son cinéma ? Et ce n’est pas à l’aube de l’autocritique, symbolisée par la profusion de médias dont la « critique » consiste à inviter le ou la cinéaste pour s’expliquer par ses références ou des phrases abracadabrantesques, et en tendant la main à celles et ceux qui font taire les histoires et les sujets qu’il faudra s’excuser de rejeter ces films illustrés et coloriés à coups de crachats, de fierté et de petitesse d’esprit.
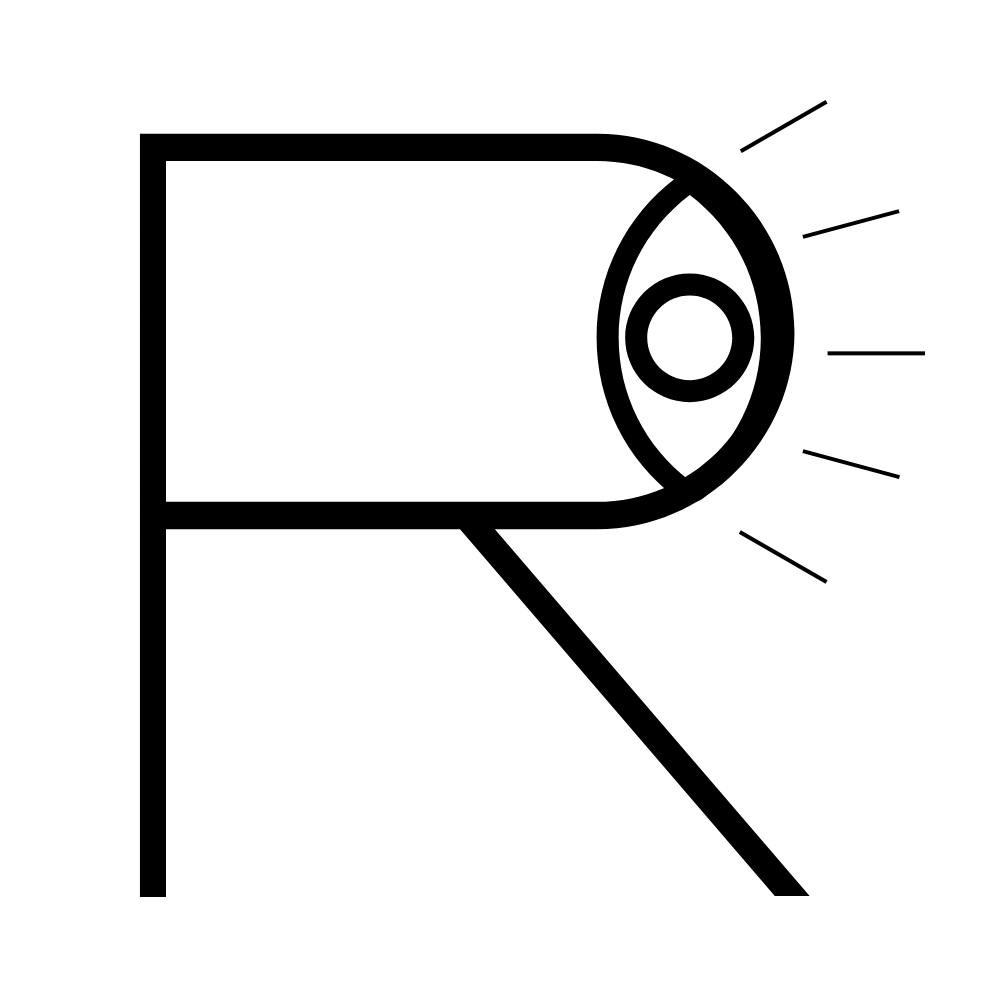

Laisser un commentaire