Retour sur l’arnaque Sirât d’Oliver Laxe : entre esthétique de prouveur et réflexes dramatiques de petit malin, un film rempli de surprises mais terriblement creux, vain et débile en substance.

Le survivalisme désertique qu’est ce Sirât d’Oliver Laxe n’a de raison d’avancer face au vent de sable que pour ce qui contient les personnages et, au fil de l’aventure, ce qu’ils perdent. Un père, accompagné de son jeune fils, veut retrouver sa fille aînée, a priori localisée dans une rave party située dans le désert marocain. Contenance, et en même temps perte : une déviance s’opère vis-à-vis de ce qui compose ce désir de retrouver, à savoir l’identité (de sa fille) et sa localisation (où elle se trouve). C’est un schéma irréprochable : le père et son jeune fils vont donc peu à peu s’enfoncer dans le désert, en compagnie de raveurs, pour évidemment perdre tout repère et toute identité, dans un existentialisme de la plus haute incongruité. Difficile de reprocher à Oliver Laxe de dupliquer son scénario (qui n’est que prétexte) et le décalquer sur ce qui va faire évoluer les personnages et finalement les caractériser : la recherche est une fabrique du néant, et ils ne trouveront que cela. Une révélation de ce vers quoi le film tend.
Mais ce n’est pas n’importe quel néant : sa fabrique comme son résultat se révèlent au fur et à mesure d’une déferlante ininterrompue de chaos, dans l’ombre bien justifiante (et très énervante) d’une possible troisième guerre mondiale, tranquillement à l’abri de la poussière, au chevet de la moindre manière.
Dans une scène montée comme un climax précoce, le père (joué par Sergi Lopez) va perdre son fils. L’ampleur de la bêtise de cette scène, qui est aussi l’un des tournants de l’histoire, se joue sur deux niveaux. Le père l’obligeant à monter dans une voiture pour se protéger du vide situé sous les pieds des personnages, la mise en scène bascule soudain de point de vue, filmant le garçon rejoindre le véhicule, depuis l’intérieur de ce dernier. Le montage propose alors un chassé-croisé entre les points de vue du fils et du père, avant que la voiture ne perde l’équilibre et recule sans fin vers le précipice, avec l’enfant à son bord, sous les yeux d’un père d’abord médusé et ensuite choqué par l’ampleur du drame. Le choc provoqué par cette scène n’aurait d’autorité que si la mise en scène n’avait pas fait preuve non seulement de cruauté vis-à-vis du père, tout de suite positionné comme le parfait coupable, et d’une immense lâcheté vis-à-vis du fils, dont il faudrait presque ici se rapprocher – être à l’intérieur de la voiture – pour mieux en cerner les derniers instants. Cette démission de la mise en scène dans le rapport père/fils prend le spectateur en otage d’un véritable chantage affectif : continuer à regarder au prix d’une mort placée sous l’autel de la sensation. Ce n’est pas un déchirement, mais du déchiffrage.
C’est en cela que les motifs de recherche et de perte qu’affichent les personnages de Sirât relèvent davantage d’un certain maniérisme que d’une évolution équivoque au cœur d’une métaphore de l’enfer – et sa deuxième partie l’atteste à bien des égards. Le père n’est plus identifié par la recherche de sa fille (ce qui le contient), mais désormais par la perte du fils. Cet insupportable troc de sentiments compensatoires vient, pour le coup, dérégler tout rapport au danger, à la solitude et, donc, à la perte de repère qu’à peu près tous les films se passant dans le désert se sont un jour décidés de traiter. Cela prouve que convoquer des Mad Max ou des Sorcerer relève autant de l’amateurisme que d’un énoncé bien écrit. La scène montrant le père s’enfonçant seul dans le désert, quelques instants après la mort du fils, ajoute une touche de désespoir complètement regardant vis-à-vis du chantage exprimé plus tôt : le film se vantant d’avoir tué un personnage clé, il enfonce le clou en suresthétisant la détresse. C’est d’ailleurs quand le père s’allonge les yeux fermés, faisant face à la tempête de sable dans la nuit, que le film prend enfin une respiration, mettant de côté ses réflexes de petit malin – mais ça, c’était avant qu’un énième fondu enchaîné sur le soleil (il fait chaud dans un désert) ne vienne rompre le contrat de confiance (Darty, j’ai besoin d’une clim’).
Dans Sirât, on bouge pour chercher, on crève pour se trouver. Et c’est paradoxalement quand le film s’arrête qu’il entrevoit la possibilité d’une issue épurée et différente de son système iconographique. Autre scène fonctionnant dans un circuit tout aussi fermé que celui de son propre mouvement, cette longue et interminable quête vers l’échappatoire d’un champ de mines (forcément) invisible. Si Oliver Laxe ne joue pas ici avec les points de vue de ses personnages pour mieux faire percer son drame, il joue avec le hors-champ pour ne produire rien d’autre que des effets de surprise. Le champ de mines, à priori l’endroit le plus dénué de mouvements pour survivre, forcera pourtant les personnages à bouger, et avec eux des objets, pour mieux trouver l’issue. D’aucuns diront que la nécessité du déplacement ici repose sur le fait que les personnages mourraient s’ils faisaient le contraire. Mais si le combat du film est de filmer des gens qui bougent pour ne pas crever de soif ou de faim, c’est vraiment prendre les spectateur.rices pour des imbéciles. Ainsi, dans sa quête d’un mouvement qui contiendrait les personnages dans ô combien de situations renversantes, le film produit irrémédiablement une mise en scène de la compensation, par effet de surprise, toujours bien installé dans la lâcheté de son propre prétexte.
Main dans la main sur cette « ligne des enfers », que le titre du film nous rappellera d’emprunter quand même 30 minutes après un premier carton de citation (Zzzzzzzzzz), Oliver Laxe et ses effets s’emmitouflent mutuellement et avec fierté pour mieux faire suivre les uns dans son délire, et mieux faire crever les autres qui s’arrêteraient.
Alors plutôt crever.
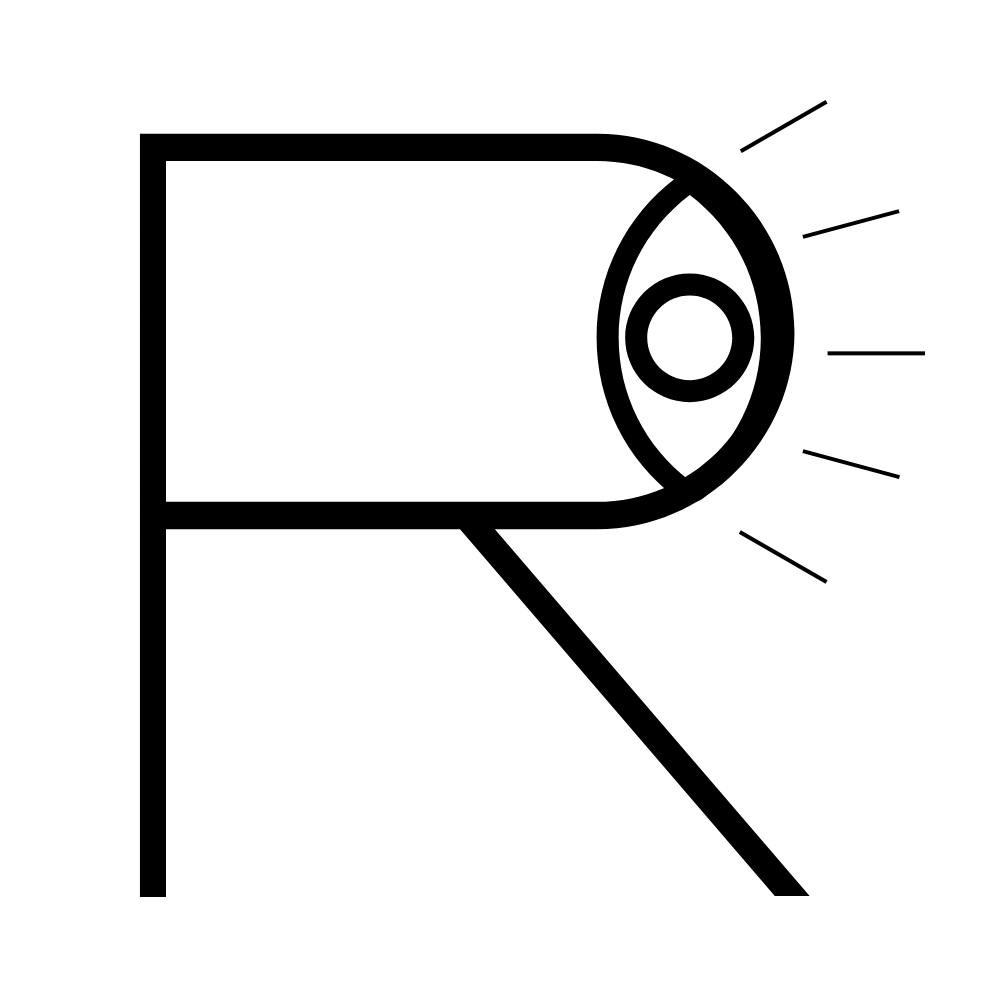

Laisser un commentaire