Trois articles pour trois films en trois parties. Deuxième partie de ce triptyque avec Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson. Ou comment la structure narrative encadre ici une action vertueuse et au cœur de laquelle trois personnages sondent une nature intérieure autant naturelle qu’en devenir.

PARTIE I – Pourquoi ?


« Il était une fois la révolution. »
Les films de Paul Thomas Anderson s’assimilent à de véritables tourbillons dans lesquels circulent des personnages définis par des motifs ô combien passionnants (l’illusion, le destin, la romance…) et dont l’une des altérités principales, en tout cas celle qui va me servir dans ces lignes, serait la quête identitaire. Il faudrait une autre série d’articles pour y déceler les troubles qui les saisissent dans cette aventure intérieure : je commencerais avec Freddie Quell dans The Master, vétéran de la Seconde Guerre mondiale dont la vie d’après ne trouve raison que dans le faux, comme influencé par l’ivresse de l’alcool et les mirages d’un charlatan. Ou sinon avec Daniel Plainview dans There will be blood, désuni entre l’ambition du « oil man », l’absence de responsabilité paternelle, la gangrène des faux-semblants et son penchant sociopathe (« I hate most people », réplique culte). J’y ajouterais volontiers les courses romantiques qui définissent la jeunesse de Licorice Pizza, le couple de Phantom Thread dont les reflets de l’amour n’existent que par les miroirs de leurs différentes personnalités, ou sinon la perversité des prétextes imposés au personnage d’Eddie Adams dans Boogie Night, le mal-aimé devenu coqueluche de l’industrie du porno.
Tourbillons aussi parce que le cinéma de PTA est pourvu d’ivresses, traduites entre autres par de savoureuses scènes de dialogues (à retenir, les grandes envolées du regretté Philip Seymour Hoffman dans Punch Drunk Love et The Master ou la puissance de Daniel Day-Lewis dans There will be blood et Phantom Thread), un sens du mouvement à en perdre la tête (les travellings de Magnolia, le rythme divaguant de Inherent Vice ou effréné de Boogie Nights) et emprunte d’une ampleur digne d’odyssées : bien souvent américaines, à hauteur de personnages, bien souvent sujets à une aura, une atmosphère, dont la complexité, et c’est certain, a de quoi rendre fou. Le nouveau film du cinéaste, Une bataille après l’autre, vient particulièrement tendre cette double sensation d’une circulation dans l’action, quand cette mise en scène transporte les personnages dans cette ivresse de l’agitation existentielle. A tel point qu’à la lumière de sa narration en trois parties, le film vient poser une question tout à fait passionnante, qu’à mon sens aucun autre film du cinéaste, si ce n’est Licorice Pizza et dont Une bataille après l’autre hérite de l’action continue, n’avait réussi à dramatiser. A savoir : comment les mouvements du film identifient et définissent, l’un après l’autre, chaque personnage ?
La première circulation qui me semble importante à saisir avant même d’entrer dans les trois grand tableaux qui nourrissent la narration est la façon dont le mouvement révolutionnaire est un sujet de mise en scène pour Paul Thomas Anderson. Les premiers plans du films viennent à ce titre donner un tempo. Une jeune femme, casquette sur la tête, repère sur un pas lent un camp de migrants détenus illégalement à la frontière mexicaine, marchant en aller-retour depuis un pont qui surplombe ce camp. La musique de Jonny Greenwood atteint un drop, à mi-chemin entre l’épique et le dramatique, au moment où son regard se pose sur le camp, sur un plan en plongée intégrant ce dernier et la marche du personnage. En seulement quelques images, le programme du film est tout indiqué : il s’agira de capter un soulèvement (la hauteur du personnage par rapport à sa cible) dont le sens en aller-retour ne dévie jamais de son objectif principal et n’a de direction et de regard que vers une injustice à réprimer. C’est notamment avec la scène suivante qu’un tel repérage servira à programmer une action collective à laquelle prendra part la jeune femme, et à identifier cette action, menée par les French 75 dans les années 2000. Cet écoulement du geste révolutionnaire, comment il s’exécute comme il résiste – tel serait son aller-retour, entre action et résilience – est la principale focale de PTA pour mieux cerner ses personnages et les actions qui les constituent. D’autres scènes, souvent très savoureuses, épousent la rébellion pour mieux réactualiser le programme détaillé dans les premières minutes. Cela peut être un coup de téléphone qui s’étend à rallonge à cause d’un mot de passe oublié (où l’on parle même de « manuel de la rébellion »), un système de détection mélodique permettant de sonder la confiance de l’un vers l’autre, ou tout simplement, un couvent de religieuses révolutionnaires. L’atmosphère, en somme, est propice aux bouleversements des équilibres.
Une bataille après l’autre s’apparente lui-même à un manuel en trois étapes du système auquel appartiennent ses personnages. Ces étapes sont les trois tableaux que le film se charge de dépeindre, l’une complétant l’autre pour mieux faire suivre une logique. Et c’est aussi parce que le film s’attelle à raconter une histoire de famille que cette structure narrative convient autant à faire (dys)fonctionner la dynamique de révolution qu’à s’intéresser à celles et ceux qui y participent. En l’occurrence ici, les trois personnages visés sont Perfidia Beverly Hills (interprétée par Teyana Taylor), la jeune femme évoquée plus haut, son compagnon Pat « Ghetto » Calhoun désormais surnommé Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) et leur fille Charlene Calhoun plus connue dans le film sous le nom de Willa Ferguson (Chase Infiniti).
Le premier mouvement revient à cultiver en même temps une histoire de la révolution et une histoire de famille, un cycle racontant comment un ménage et un combat sont liés par une action ascendante (la floraison de la révolte, la naissance de l’enfant) et descendante (la chute et la séparation). Il concentre pourtant une impossibilité, celle de faire corps entre la famille révolutionnaire et la famille de la maison. C’est en ce sens que le personnage de Perfidia Beverly Hills est le visage de cette première partie, tant il est le centre de gravité du trouble qui va agiter les personnages de son vivant, mais aussi après sa disparition, hors de l’image, quand la caméra filmera une famille héritière de son absence. En effet, Perfidia n’arrive pas à faire de son corps révolutionnaire celui d’une mère présente, accusant même son compagnon d’avoir choisi son camp au détriment de la révolte qui grondait jadis entre eux – et ce avec ivresse, à en témoigner la tension sexuelle qui régissait certaines de leurs actions. Par ailleurs, elle engage une relation ambiguë avec un militaire du nom de Steven Lockjaw (l’éblouissant Sean Penn), sorte d’action-man puritain dont le white power qu’il incarne se fond dans une obsession pour les femmes noires. Quel équilibre… Ensemble, rendez-vous cachés et arrangements teindront la mouvance des French 75 d’un échec foudroyant, entre arrestations, exécutions sommaires et, pour le compagnon et la fille de Perfidia, une disparition dans la peur, au cœur de la nuit. Ainsi va le cycle de la révolution pour Paul Thomas Anderson, quand le soulèvement n’aboutit qu’à une descendance fracturée. Qui est donc Perfidia Beverly Hills ? Une femme dont l’autorité qu’elle a incarnée en tant qu’activiste (« Make it good, make it bright ») et qu’elle a subie (sa résignation) est le symbole d’un cycle que la révolution se doit d’écrire au passé – la première partie peut faire office d’un vaste flashback – comme au futur, avec ce qui suit. Ainsi vient l’héritage, ainsi vient la véritable révolution : ainsi vient l’équilibre du temps.
Sur une transition purement kubrickienne, le film montre le visage d’un bébé en fuite dans la nuit se greffer à un autre visage, pur et conquérant, celui des « années qui ont passé », mais surtout celui d’une jeune femme en pleine récitation de gestes d’arts martiaux. Willa Ferguson s’assure et respire, quand son père, Bob, toujours dans la voiture, aspire une drogue pour se préparer à un rendez-vous parents-profs. Et c’est autour de cette immobilité du père – dans un contexte où l’énergie de la vie persiste, à en témoigner l’assurance de Willa – que PTA va construire tout le second mouvement qui va suivre, lequel est enclenché par le même Steven Lockjaw par l’intermédiaire d’une opération de chasse contre les Ferguson, déguisée en contrôle grandeur nature des clandestins. Outre toutes les manœuvres que Bob mènera pour assurer une révolution surprotective vis-à-vis de sa fille (pour mieux résister aux démons qui les traquent) ou statique depuis son canapé à regarder La Bataille d’Alger de Pontecorvo, l’enjeu de cette seconde partie repose sur l’imbrication entre la résurgence d’une fièvre révolutionnaire et l’urgence d’un présent incarnée également par une surprotection et un immobilisme : celui de la toute puissance de l’Etat blanc et policier de l’Amérique post-2016. Il va être question de reconquérir une endurance combative (la fuite), « refaire réseau » avec les camarades du mouvement (mots de passe téléphonique, un précieux Sensei) et de retrouver un état d’esprit de conquête à la limite du borderline (insultes, cris, slogans). En tout et pour tout, une révolution qui cabotine, un double mouvement entre sursaut du combat et urgence de la fuite qui double forcément le plaisir d’assister à du cinéma dont les rails sont fabriqués avec l’étoffe des héros andersoniens : une perpétuelle et inarrêtable quête d’eux-mêmes – ici, l’identité du père se pose par une question toute simple : où est sa fille ? Car au-delà de se cacher des troupes de Lockjaw, Bob a la volonté de retrouver sa fille et de savoir où elle se cache : l’urgence est de fuir, mais aussi de vouloir retrouver. Qui est donc Bob Ferguson ? Un père dont la fuite n’est motivée que par l’envie de retrouver sa fille dans un contexte qui semble le dépasser, mais qui le rend plus vivant que jamais – le combat continue. C’est dans cette fièvre qu’il détonne une réplique qui, dans le pouls de l’action et de la révolte sous-jacente qui le constitue, entrouvre la voie vers la résolution : « Life, men… LIFE ! ».
Le troisième mouvement du film s’amorce par deux situations initiales, quand les deux précédents faisaient état d’une seule exposition pour amorcer leur action, mais toujours vis-à-vis d’un seul et même personnage. Ici, tout va tourner autour de Willa, dont la sécurité est assurée après avoir été exfiltrée du bal du lycée par d’anciens camarades des French 75. Cependant, Lockjaw retrouve sa trace et la confronte à une vérité qui expliquait toute l’entreprise de traque du mouvement précédent : elle est en fait sa fille, résultat de la liaison entre lui et sa mère. Cette vérité, et la nécessité de la faire disparaitre, s’affiche en même temps que la recherche de Bob pour sa fille, à bord d’une voiture de tuning à la vitesse douteuse (ou le mélange parfait entre esprit populaire et cabotin). Willa se retrouve finalement face à deux vérités pour le spectateur. Il y a le lien du sang, indéfectiblement raciste et puritain, et l’autre lien qui va lui permettre de combattre le premier : celui de son père. Ainsi, Willa va se retrouver à la tête d’un énorme jeu de pistes, au cœur des routes du désert californien, dans un mouvement de course-poursuite dont l’épure rabat les cartes du cinéma d’action d’auteur à un niveau peu atteint par les pairs de Paul Thomas Anderson (jusqu’à remonter aux origines d’un tel imaginaire, à savoir Duel de Steven Spielberg).
Après avoir finalement échappée aux griffes des ravisseurs engagés par Lockjaw pour la faire disparaitre, elle se retrouve traquée par un assassin, désireux de mettre un terme à l’hérédité « batarde » entre Lockjaw et Willa au nom du white power – un parasite (*) qui mettra Lockjaw hors course en le sortant violemment de la route. Bob, à bord de son tracteur, finit par se retrouver derrière les voitures vrombissantes de Willa et de l’assassin. En plus de fuir, les personnages se courent après… Après avoir éliminé son ravisseur, la jeune femme se retrouve face à son père, assistant aux dégâts, et lui demande de s’identifier à partir des mots de code du mouvement révolutionnaire, que son père lui a appris pour se protéger. Ainsi vient l’autre cycle de la révolution selon Paul Thomas Anderson, quand le soulèvement, qu’il soit propre à une révolution ou à une route qui s’élève, revit sous le signe de l’héritage : pour mieux apprendre à s’identifier et se reconnaître – chose que Perfidia n’avait jamais pu faire auprès de sa fille et de son camarade devenu père. Une famille qui se recherche avant, qui se reconnaît après, dans le feu de l’action, tel est ce qui motive ce putain de film à rendre la virtuosité de nos rapports familiaux et politiques aussi utile qu’intemporelle. Alors, qui est donc Willa Ferguson ? Elle est ce futur dont la fuite n’a d’intérêt que si elle s’ajoute à une action – la révolution – et à une reconnaissance – sa famille. Fuire aussi en réparation pour sa mère, qui s’est faite attraper. C’est en ce sens que la lettre de sa mère, lue par elle-même en voix off, trouve un sens en tout point émotionnel : la révolution est une histoire de famille. Le cycle redémarre, le mouvement se soulève de nouveau : Willa, sans la permission de son père, part pour une action, sans promettre d’être prudente. Une mère, un père et une fille lié·es par le fil de la révolution, et de la fuite qu’elle leur a incombée à un moment donné de leur existence, chacun leur tour. La bataille désignée par le titre du film est celle incarnée par chaque membre de la famille : une bataille est un mouvement initiée par une fuite, celle de la révolution. Il y en aurait donc trois. Comme dans Oui de Nadav Lapid, la fuite revêt ici une nature. A la différence près que, lorsque le premier semble savoir pourquoi il faut fuir, le second sait avec qui. Il ne reste plus qu’à savoir comment.

(*) Lockjaw, l’antagoniste principal du récit, est envieux de rejoindre la secte des « Aventuriers de Noël », regroupant des hommes blancs défendant un certain puritanisme dans la grande et belle contrée des Etats-Unis d’Amérique. Sauf que les principaux acteurs de cette secte découvrent la liaison entre Lockjaw et Perfidia, et la naissance de Willa qui s’en est suivie. Ce qui aboutira à l’engagement d’un tueur à gage pour « nettoyer tout cela », c’est-à-dire supprimer Lockjaw et Willa, pour faire disparaitre tout « mélange » compromettant le puritanisme du white power.
Il est intéressant de constater jusqu’à présent l’influence des antagonismes dans cette « règle de trois ». Oui et Une bataille après l’autre sont motivés par le même motif, proche du pacte avec le diable, selon lequel des forces bien supérieures à de simples personnes peuvent influencer le cours de l’existence. Dans le cas du film de Nadav Lapid, la mission confiée à Y. de composer un nouvel hymne à Israël, louant à la fois sa gloire mais aussi un destin criminel, vantant la destruction de Gaza et de la Palestine. Pour Paul Thomas Anderson, la mission solennelle des Aventuriers de Noël de rendre toutes les lettres de noblesse à une classe blanche, autoritaire et bourgeoise pour annuler toute inclusion et insurrection. Si le rapport à cet antagonisme diffère entre ces deux films – bien que sur la question du legs, Y. semble davantage faire héritage d’un hymne que d’un enfant -, le rapport à une certaine actualité politique semble tendre les deux films pour mieux dessiner une perspective de fuite.
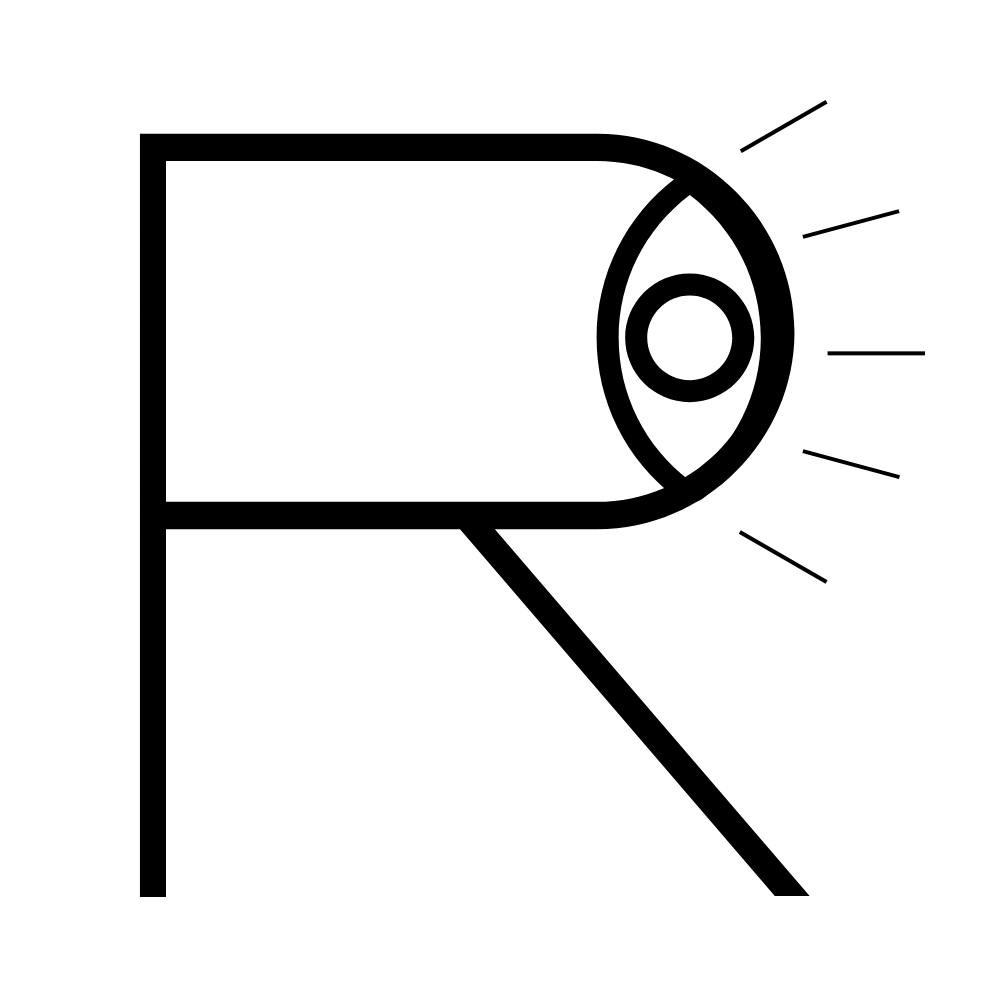

Laisser un commentaire